Keaton tourne La croisière du Navigator en 1924, juste après Sherlock Jr, dont l’intrigue est aussi complexe que celle du Navigator est simple : un homme et une femme se retrouvent coincés, seuls, sur un paquebot à la dérive au milieu de l’océan. Cette simplicité, bien sûr, n’empêche pas la profondeur du propos (ni le niveau de l’eau).
Buster Keaton personnifie encore un de ces gosses de riche oisifs et inaptes dont il a le secret, et ici son Rollo Treadway ressemble trait pour trait (et pour cause) à son Alfred Butler du Dernier round ou à son James Shannon des Fiancées en folie. Il joue à la perfection le nanti plus ignorant que mal intentionné, dont l’étourderie n’est que l’indice d’une profonde méconnaissance des usages du monde (et des femmes). Les plans d’exposition du jeune milliardaire montrent encore le goût de Keaton pour la symétrie, comme ce plan large de l’immense salle de bain où Rollo pénètre d’un air à la fois blasé et rêveur, pour prendre le bain préparé par son valet stylé, dans une baignoire creusée dans le sol qui occupe le centre de l’écran. Il entre dans l’eau sans se déshabiller, et ne s’aperçoit de son oubli que quand il commence à savonner sa somptueuse robe de chambre.
Sa toilette faite, il décrète qu’il va se marier le jour-même. A peine surpris, le valet part sur le champ lui acheter les billets d’une croisière de luxe pour deux personnes. Rollo se fait alors conduire par son chauffeur chez sa fiancée (qui habite la maison d’en face : la voiture effectue une élégante courbe de quelques mètres d’un côté de la rue à l’autre). Mais las ! La « fiancée » (une gosse de riche comme lui) n’est au courant de rien, et quand il la demande en mariage de but en blanc, c’est l’inévitable râteau. Il est si triste que plutôt que de prendre la voiture pour rentrer, il préfère traverser la rue à pied (« Je pense qu’une longue marche me fera du bien. »)

Les hasards (un peu forcés) du scénario font que Rollo / Buster Keaton se retrouve sur le Navigator qui dérive sur l’océan avec celle qui vient de refuser de l’épouser, Betsy / Kathryn McGuire (qui était déjà la jeune première de Sherlock Jr). Mais il s’agit d’abord pour les deux jeunes gens de se trouver : une série de séquences chorégraphie la recherche de l’Autre, dont on sait qu’il existe mais qu’on n’arrive jamais à rattraper. Keaton et sa partenaire passent leur temps à se manquer, à se deviner à quelque indice (un mégot encore fumant sur le sol), à se rechercher, puis à se courir après de plus en plus frénétiquement, ce qui donne lieu à des plans larges d’une grande virtuosité où l’un entre dans le champ quand l’autre en sort, où les trajectoires se croisent et se frôlent sans jamais se rencontrer, dans un ensemble d’arabesques splendides. (Et c’est quand ils auront l’un et l’autre renoncé à la frénésie et cédé à un certain découragement que Keaton, aspiré par une bouche d’aération où son chapeau haut-de-forme vient de disparaître, tombera littéralement sur la jeune femme – et sur son chapeau, qui n’aura plus de haut-de-forme que le nom.)
Une fois établi qu’ils sont les deux seules personnes sur un paquebot au milieu du Pacifique, il va leur falloir survivre à la situation. D’abord parce que ni l’un ni l’autre ne savent fonctionner sans leur petit personnel, ensuite parce que le navire étant prévu pour des centaines de passagers, tout est à une échelle quelque peu cyclopéenne, à commencer par les cuisines. Réussir à manger est la première difficulté, et une difficulté de taille, une difficulté de la taille gigantesque de tous les ustensiles. Les débuts sont catastrophiques (et Keaton n’est pas aidé par la jeune femme, qui met trois grains de café non moulus dans la cafetière géante – un peu comme la jeune première du Mécano de la General mettra avec application de tout petits morceaux de bois dans l’énorme chaudière de la locomotive). Puis, selon le schéma keatonien classique, incompétence – adaptation – suradaptation, les choses s’arrangent (c’est-à-dire que les choses sont arrangées), et le milliardaire somnambulique, obligé de mettre les mains dans le cambouis, trouve en lui les ressources d’une surprenante efficacité poétique, en transformant la cuisine en une incroyable série de bricolages compliqués destinés à permettre la préparation de repas pour deux personnes. (On retrouve ce type de bricolage improbable dans plusieurs des films de Buster Keaton, courts ou longs, et le Keaton de la vraie vie était parait-il friand de ces montages complexes jusque dans sa propre maison.)
Gilles Deleuze dans L’image-mouvement parle de la fonction « minorante » de la machine : Dans « La croisière du Navigator », la machine, ce n’est pas seulement le grand paquebot par lui-même : c’est le paquebot pris dans une fonction minorante où chacun de ses éléments, destinés à des centaines de personnes, va être adapté à un couple tout seul et démuni. (…) Chez Keaton, la machine ne se définit pas par l’immense, elle implique l’immense, mais en inventant la fonction minorante qui le transforme, grâce à un système ingénieux lui-même machinique prélevé sur la masse des poulies, des fils et des leviers. (…) Telle est la finalité de la machine elle-même : elle ne comprend pas seulement ses grandes pièces et rouages, elle comprend sa conversion en petit, sa conversion au petit, le mécanisme d’une transformation qui l’approprie à un homme solitaire, à un couple perdu, par-delà les compétences et les spécialisations. Deleuze y voit même la possibilité d’un Keaton « politique » dans l’idée d’une sorte de socialisme « machinique-anarchiste » où les grandes machines pourraient être utilisées de façon individuelle.

Ce bateau-monde, où un couple d’Adam et Eve qui sont les produits un peu dégénérés d’un capitalisme malade doivent se réinventer une existence, ce bateau-machine qu’il faut adapter pour la vie à deux, a semble-t-il été le déclencheur du film entier : Jean-Pierre Coursodon dans son Buster Keaton raconte que Fred Gabourie, directeur technique de presque tous les films de Keaton jusqu’au Cameraman (et membre de la tribu indienne Seneca), faisait des repérages de vieux voiliers pour le tournage de L’aigle des mers (1924) de Frank Lloyd, quand il tomba par hasard sur un grand navire voué au démantèlement, le Buford. Connaissant le goût de Keaton pour les machines, grandes ou petites, et les moyens de locomotion en tous genres, il le prévint immédiatement, et Keaton décida tout aussi immédiatement de louer ou d’acheter le bateau pour en faire un film.
Ce film, paraphrasant Georges Perec et sa Tentative d’épuisement d’un lieu parisien, pourrait s’appeler Tentative d’épuisement d’un paquebot de croisière. Le Buford rebaptisé Navigator est utilisé sous toutes les coutures, de la poupe à la proue, de la cale aux ponts, dans tous ses recoins et tous ses conduits. Il n’y a guère que dans les mâts que Keaton ne va pas (mais il réparera cette omission dans Le figurant en 1929 où la seconde moitié du film se passe aussi sur un bateau et donne lieu à quelques morceaux de bravoure dans les vergues). Le personnage de Keaton, cependant, malgré son appétence machinique, n’essaye jamais de mettre en marche la moindre chose qui, dans la salle des machines, pourrait servir à faire avancer ou diriger le grand navire. Il faut dire que trouver le moyen de se servir d’une marmite géante est une chose, mais utiliser la machinerie d’un paquebot en est une autre, sans doute parfaitement inaccessible à un homme seul (les deux jeunes gens ont de toute façon élu domicile dans les deux énormes chaudières du navire, transformées en coquettes chambres contiguës.) A jamais ingouvernable, le Navigator ne navigue pas, il dérive au hasard.
Et une fois de plus, il faut le dire, comme dans à peu près tous les films de Keaton, la femme est un boulet. La jeune personne est certes décorative et pleine de bonnes intentions, et elle fait de jolis nœuds avec les tranches de lard, mais d’une manière générale elle est d’une efficacité douteuse. Elle demande à Rollo/Keaton de tracter le Navigator avec un canot de sauvetage pour rattraper le navire militaire qui s’est détourné d’eux (elle lui a fait hisser le pavillon jaune de la quarantaine parce que la couleur lui plaît), et une fois que le canot a coulé et que Keaton manque de se noyer, elle l’assomme avec la bouée qu’elle lui lance. Après qu’elle soit tombée elle-même à l’eau, il plonge la repêcher et doit la remonter sur le pont, tandis qu’elle feint d’être évanouie. Il tente alors de l’installer sur une chaise longue, mais la chaise ne cesse de s’écrouler et la jeune femme de lui glisser entre les mains (c’est là une sorte de brouillon du très long gag du Figurant où Keaton essaie de mettre au lit la femme qu’il vient d’épouser et qui est ivre-morte.) Plus que la chosification de la femme (devenue une sorte de sac de pommes de terre qu’on trimballe sur l’épaule ou qu’on cherche à faire tenir sur une chaise – Keaton mettra d’ailleurs littéralement sa fiancée en sac dans Le mécano de la General pour lui faire passer les lignes ennemies), c’est ici l’insupportable et navrante pesanteur de la réalité qu’il faut se coltiner. La femme désirée, rêvée, fantasmée, a aussi un corps bien réel, lourd, difficile à manier, et le personnage keatonien doit en faire l’apprentissage (la chair est triste, hélas, et pèse toujours quelques livres de trop.)

On pourrait multiplier les exemples de la nature à la fois encombrante et inapte du personnage féminin, qui est comme toujours un des « nœuds » du problème keatonien. Parlant de nœuds, il y a aussi évidemment un certain nombre de sous-entendus sexuels (on devrait pouvoir parler, pour un film muet, de sous-vues). Un des plus visibles, justement, et des plus explicites (en mettant de côté les nœuds de lard fumé mentionnés plus haut), c’est cette séquence où Keaton, qui vient d’effrayer les cannibales en sortant de l’eau en habit de scaphandrier, délivre la jeune femme et s’enfuit avec elle en retournant à la mer, lui flottant dans son scaphandre, elle à califourchon sur lui et pagayant pour faire avancer ce curieux assemblage. Outre la position très sexuelle (et l’aspect de préservatif géant pris par le héros), c’est aussi la domination de la femme qui nous frappe (avec l’homme qui en fin de parcours commence clairement à étouffer sous son casque), et le fait que pour une fois c’est elle qui fait avancer les choses (peut-on y voir les signes, en parallèle de l’évidente misogynie keatonienne, d’un masochisme profond ? Mais ne serais-je pas en train, une fois de plus, de me livrer à une de mes marottes favorites, la psychanalyse de Prisunic ? (Il faudrait d’ailleurs peut-être que j’actualise ma marotte : psychanalyse de Franprix avant couvre-feu ?)) (Et si je voulais aller plus loin dans ma marotte actualisée, j’ajouterais qu’en anglais les bateaux sont des choses féminines (« She’s quarantined » dit l’officier du navire militaire qui vient de voir le pavillon jaune hissé par le Navigator.) Le Navigator est donc une navigatrice, l’immense machine est une femme, ingouvernable donc, mais qu’on peut aménager pour la rendre confortable.)
Et pour poursuivre dans l’abus de marotte, que dire de cette interminable série de chapeaux perdus par Keaton, tous emportés par de mystérieux coups de vent ? N’y aurait-il pas comme une angoisse de castration dans ce gag récurrent d’un mâle qui ne cesse de se voir dérober son attribut favori ? Comme les chapeaux sont tous différents, on peut aussi y voir, si on a l’esprit mieux tourné que le mien, une sorte de défilé décalé de mode chapelière (d’autant que le gag consiste en ce que Keaton, aussitôt un chapeau envolé, en a tout de suite un nouveau sous la main – il y a une séquence dans Steamboat Bill Jr où, dans le même genre de fixation sur le couvre-chef, son père lui fait essayer des tas de chapeaux différents, alors que lui ne veut porter que le béret qu’il a au début du film – et dans les deux cas, il y a aussi le clin d’œil au canotier habituel du comique.) En tout cas, qu’on ne me dise pas que le haut-de-forme réduit à l’état de piteuse galette ne signifie rien…

Le scaphandre déjà mentionné est le point de départ d’une longue et célèbre séquence sous-marine, où Keaton va au fond de l’eau tenter de réparer le bateau qui s’est ensablé, séquence réalisée comme toujours sans trucages, avec une réplique de la coque du navire. Le tournage devait avoir lieu dans une piscine locale, rendue plus profonde par la construction de murs tout autour du bassin existant. Mais le fond de la piscine ne supporta pas le poids d’eau supplémentaire, et il fallut rembourser les dégâts, et trouver un autre lieu : ce fut le lac Tahoe, grand lac de montagne réputé pour ses eaux très claires, mais aussi très froides. Keaton ne pouvait pas tenir plus de quelques minutes sous l’eau, et le froid posait aussi de nombreux problèmes techniques. Mais curieusement, ce tour de force humain et technique, qui a pris jusqu’à quatre semaines de tournage, m’a laissée, comme les eaux du lac Tahoe, froide. C’est, je crois, un des aspects de Keaton qui me touche le moins, sa veine « fantaisiste » (il coupe un filin récalcitrant avec la pince d’un homard, il se bat en duel contre un espadon avec le rostre d’un autre espadon attrapé à cet effet). J’aime bien, par contre, le panneau « Travaux » qu’il pose au fond de l’eau, et surtout le gag du seau d’eau, où, les mains noircies par la graisse du gouvernail, il prend un seau, le « remplit » d’eau, se lave les mains dedans, s’essuie avec un mouchoir, puis rejette l’eau sale dans l’eau propre – on dirait la recette de la sauce aux câpres sans câpres de Pierre Dac, exclusivement composée d’eau…
Mais surtout, je pense que ce qui me manque le plus dans cette séquence sous-marine, c’est le corps et le visage de Keaton, escamotés par l’encombrant scaphandre. Évidemment, l’objet scaphandre, dans son étrangeté foncière, donne lieu à plein de gags très marrants, depuis les difficultés diverses pour y rentrer jusqu’aux difficultés encore plus grandes pour en sortir (et un final qui ressemble à un curieux accouchement, avec d’abord l’ouverture au couteau d’une poche ventrale dans le scaphandre, puis Keaton la tête en bas perdant les eaux), et entre les deux, la presque tragédie quand ses tuyaux d’arrivée d’air sont tranchés – par les méchants cannibales venus enlever la jeune femme. (Bon, d’accord, les méchants cannibales sont un peu caricaturaux, pour certains approximativement grimés en noir, avec un chef dont le seul jeu d’acteur consiste, à intervalle régulier, à tendre le bras d’un air pénétré vers le Navigator pour envoyer ses hommes à l’attaque. Mais ça vaut les hordes d’Indiens anonymes des westerns qui ne sont là que pour faire obstacle aux héros. Et ça vaut les hordes de flics de Cops ou les hordes de femelles déchaînées des Fiancées en folie, qui sont mises au même niveau que des catastrophes naturelles.)

Plus sans doute que dans d’autres films de Keaton, le son tient une place importante dans La croisière du Navigator, avec plusieurs gags sonores. Un des plus connu est celui où Keaton, après une série de péripéties nocturnes, se retrouve sur une des passerelles menant aux cabines, dans un très beau plan géométrique : il s’avance vers nous dans un espace où la nuit noire est découpée par les structures claires du navire, devant l’enfilade des portes blanches des cabines, qui s’ouvrent et se ferment sous l’effet du roulis. Face à nous, il est frôlé dans son dos par une des portes ouvertes. Il reste interdit un moment, derrière lui toutes les portes se referment d’un coup, et quand il se retourne pour comprendre l’origine du bruit, il ne voit qu’une longue ligne de portes fermées. Il y a aussi le moment où le gramophone se met accidentellement en route, démarrant une musique où il n’est question que de marins perdus et de noyades – et une belle trouvaille visuelle affiche les paroles de la sinistre chanson sous le gramophone, entre les étagères qui en constituent l’assise.
Dans les films de Keaton, le monde a souvent tendance à se raréfier, à s’essentialiser. Le Navigator en est un bel exemple, navire hissé au statut d’univers complet, avec un couple rejouant en quelque sorte l’histoire de l’humanité, seul d’abord puis menacé par des forces barbares. Mais il y a toujours dans le film lui-même des gags qui sont eux aussi comme des images réduites de la condition humaine, de fulgurantes et étranges allégories (Petr Král dans Les burlesques ou Parade des somnambules parle d’images quasi définitives de notre situation dans le monde). Dans La croisière du Navigator il y a par exemple la séquence du canon miniature (on pourrait presque dire, d’ailleurs, pour continuer sur les brisées de Deleuze, que chez Keaton, si la grande machine peut être adaptée à un usage individuel, la petite machine peut à l’inverse être utilisée à grande échelle) : en pleine attaque des cannibales, le personnage trouve sur le pont un tout petit canon, et décide de s’en servir. Il le positionne soigneusement vers les assaillants, puis en allume la mèche. Mais en s’éloignant, il passe par inadvertance le pied dans une lanière qui s’y rattache, ce qui fait que l’arme prête à faire feu le suit comme son ombre, quels que soient les efforts qu’il fait pour s’en débarrasser.

J’y vois comme une image de la vie : on traîne derrière soi le canon qu’on a nous-mêmes armé, et qui risque à tout moment de nous exploser au visage (certes c’est sans doute un peu une spéciale dédicace aux dépressifs, mais après tout ce n’est pas pire que l’Ennemi de Baudelaire – Et l’obscur Ennemi qui nous ronge le cœur / Du sang que nous perdons croît et se fortifie). Keaton réutilisera un gag similaire dans Le mécano de la General, cette fois avec un canon plus gros, sur le même principe : le canon à la suite d’un concours de circonstances finit par viser Keaton lui-même, et dans les deux cas il arrive in extremis à échapper à la mort en s’arrangeant (volontairement ou non) pour que le boulet atteigne plutôt ses ennemis.
(Et encore, je vous épargne le côté phallique du canon et l’image d’un homme effrayé et menacé par sa propre sexualité – image d’ailleurs assez unisexe.) Mais petit ou gros canon, La croisière du Navigator, au lieu de faire long feu, fait feu de tout bois, comme ce feu d’artifice foutraque qui sert d’ultime tentative pour repousser les sauvages. La croisière s’amuse, la croisière vit, aime, mange, dort, la croisière prend feu, se désespère, se bat, la croisière se noie, meurt et ressuscite. Et Keaton n’en finit pas de voguer dans nos mémoires.
Emmanuelle Le Fur
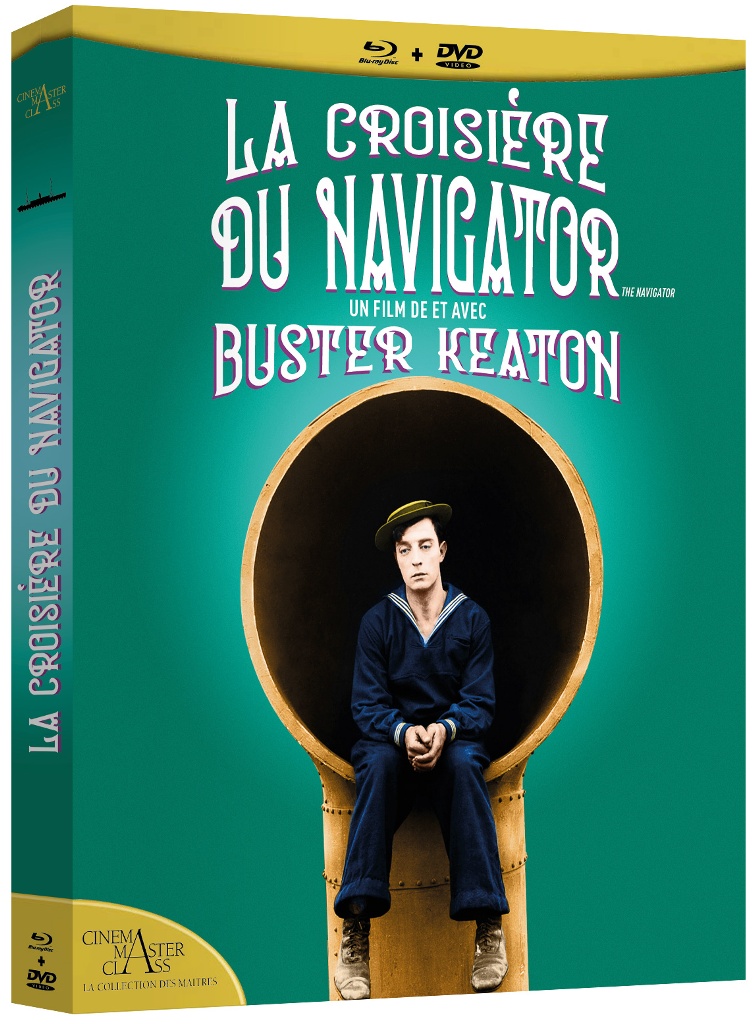
La croisière du Navigator, une édition (unitaire et combo DVD + Bluray) d’Eléphant Films dans la collection Cinéma Master Class. Master / Buster Keaton, restauration impeccable en Haute-Définition 4K par La Cinémathèque de Bologne à L’Immagine Ritrovata pour la Cohen Media Group. Eléphant Films propose en complément : Nachiketas Wignesan, enseignant de cinéma, analyse plusieurs séquences de Sherlock Junior (22 minutes). Notes sur la restauration. Les films annonces de la collection Buster Keaton (Le dernier round, La croisière du Navigator, Sherlock Junior) ainsi que Les Fiancées en folie, L’Homme qui rit et La Féerie du jazz. La belle jaquette de cette édition est réversible avec une reproduction de l’affiche française du film.
La croisière du Navigator (The Navigator) un film de Buster Keaton et Donald Crisp avec Buster Keaton, Kathryn McGuire, Frederick Vroom, Noble Johnson, H.N. Clugston, Clarence Burton… Scénario : Clyde Bruckman, Joseph A. Mitchell & Jean C. Havez. Directeur de la photographie : Byron Houck & Elgin Lessley. Costumes : Clare West. Montage : Buster Keaton. Producteurs : Buster Keaton & Joseph M. Schenck. Production : Buster Keaton Productions – Metro-Goldwyn Attraction – MGM. Distribution (salles France – reprise en 2019) : Splendor Films. Etats-Unis. 1924. 66 minutes. Noir et blanc. Format image : 1.33 :1. Son : Accompagnement musical de Robert Israel – DTS HD Stéréo 2.0 et 5.1. Dolby Digital 2.0. Sous-titres français. Tous Publics.
