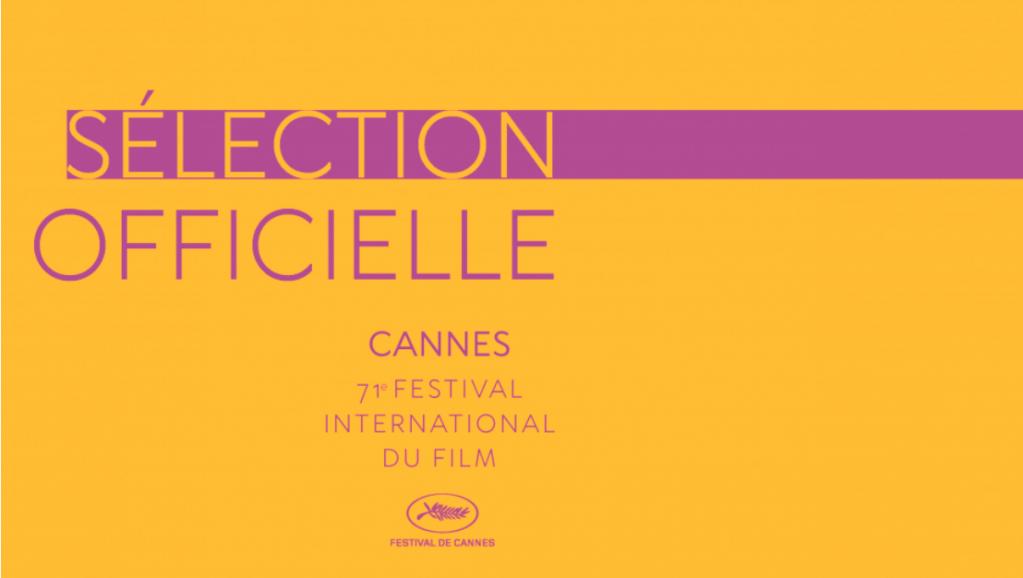La 71e édition du Festival de Cannes est terminée. C’était une année de controverses et de protestations, pas seulement pour les films qui ont été projetés là-bas mais aussi pour les choix de la sélection, le choix du jury, la quasi-absence du cinéma américain… Netflix a refusé de soumettre ses films en raison d’un changement de règles contre les distributeurs en streaming.
La présidente du jury Cate Blanchett, ainsi que 81 réalisatrices, actrices et activistes, se sont tenues sur les marches du Palais pour réclamer un plus grand accès pour les réalisatrices et la parité entre les sexes dans la compétition du festival. L’actrice française Aïssa Maïga, accompagnée de 15 autres personnes, a organisé une manifestation similaire pour protester contre la discrimination raciale et sexuelle dans l’industrie cinématographique française. Kristen Stewart a lancé ses chaussures sur le tapis rouge contre les talons obligatoires pour les femmes. Thierry Frémaux a signé la « Promesse de programmation pour la parité et l’inclusion dans les festivals du cinéma », s’engageant à atteindre la parité 50/50 entre les sexes d’ici 2020…
Le Festival de Cannes a accueilli un bon nombre de films cette année mais tout au long de la compétition de 12 jours, nous avons l’impression que le festival a eu une année douce et que la magie a été tassée. Aucun film n’a vraiment touché le public même si Cannes reste Cannes : le festival de cinéma le plus important du monde. Certains films ont fonctionné sans plus et d’autres pas. La question qui se pose : les programmateurs sont-ils à la merci des films réalisés ?

En attribuant la Palme d’or à Une affaire de famille du réalisateur japonais Hirokazu Kore-eda, le jury présidé par Cate Blanchett, et cela inclut tous les autres prix, a favorisé les sujets à émotions. Mais quel dommage de ne pas avoir primé des œuvres aussi majeures que celle de Nuri Bilge Ceylan !
Le Palmarès semblait un peu alourdi après que l’actrice italienne Asia Argento, en remettant un prix, a rappelé à la salle le viol dont elle aurait été victime, il y a quelques années, ici même, à Cannes par Harvey Weinstein.
La rumeur se répandait que Cate Blanchett voulait décerner la Palme à une femme cinéaste, sous prétexte qu’elle est une femme. Elle en a récompensé deux, sans les privilégier pour autant : un Prix du scénario pour Alice Rohrwacher (Heureux comme Lazzaro), petit film un peu long comme tous les films sélectionnés, où la réalisatrice, à travers l’histoire d’un simple d’esprit qui traverse le temps, tente de retrouver la grâce de grands anciens : Michelangelo Antonioni, Vittorio De Sica, Ettore Scola, mais a du mal à y parvenir…
Deuxième femme primée : la Libanaise Nadine Labaki pour Capharnaüm, l’odyssée d’un gamin dans un Beyrouth dévasté. C’est un film qui manque de subtilité. Inévitablement, il y aura ceux qui invoqueront des parallèles avec des films comme Slumdog Millionaire et d’autres œuvres de la pornographie dite de la pauvreté et se moqueront de l’amoncellement de malheurs sur le héros. Les réactions dépendront des niveaux de compassion ou du cynisme de chaque spectateur. Mais peut-on rester insensible au sort d’un enfant ? Faut-il mettre en scène la misère pour alerter les consciences ? Capharnaüm a divisé la Croisette sur les armes cinématographiques utilisées par la réalisatrice Nadine Labaki. A plusieurs reprises, elle place le curseur de l’émotion tout en haut, sans se soucier de l’invraisemblance des situations. Le dernier plan paraît-il à fait couler des larmes, dont celles de la présidente du jury Cate Blanchett… Mais plus que le sujet et ce chantage à l’émotion décriée par certains critiques, comme si ce n’était pas l’essence du cinéma de justement nous placer en empathie avec les personnages d’un film, c’est la construction du récit qui manque de rigueur. Le procès des parents apparaît ainsi comme un prétexte tiré par les cheveux pour raconter l’histoire de Zain en flash-back. Cela alourdit la structure du scénario. Mais la mise en scène nerveuse de Nadine Labaki, l’approche documentaire de la partie centrale, ne nous laissent pas indifférents aux émotions qui nous submergent quand le petit Zain veille sur Yonas, son « petit frère » d’adoption.
Devant tous ces films primés, il y avait aussi Les Eternels de Jia Zhang-Ke, le film de Kirill Serebrennikov et sa reconstitution flamboyante du rock russe des années 1980 L’Eté. Mais ces films ont-ils mieux convaincu ? Pas nécessairement, vu la division dans l’opinion et dans la presse.

La presse française dans son ensemble pensait que la plus grande erreur, que le jury devra assumer durant des années, est l’absence du Sud-Coréen Lee Chang-dong avec Burning, adapté d’une nouvelle de Haruki Murakami. Un jeune homme qui rêve de devenir romancier tombe amoureux d’une fille. De retour d’un voyage, elle lui présente son double inversé. Un jour, la jeune femme disparaît… C’est un film sur les rapports de classe et de force entre les êtres… Certains journalistes sont allés loin dans leur critique élogieuse du film : « Ne s’est-il pas trouvé quelqu’un, parmi le jury, pour expliquer aux autres ce qu’une mise en scène de cinéma veut dire ? ». Burning, en toute franchise, n’était pas au-dessus des autres films dans sa construction narrative et cinématographique à part un plan ou deux.
Pire encore, certaines presses américaines ont commencé à prédire la « fin » du Festival de Cannes : parce qu’il y avait moins, cette année, de « stars » sur les marches, ou parce que Cannes a interdit les « selfies », ou l’obstination de certaines plateformes (Netflix) à refuser que leurs films sortent dans les salles françaises. Et la bouderie d’Hollywood, préférant envoyer au Toronto, festival non compétitif, donc sans risque, ses productions les plus précieuses…
Mais la réalité est que tous les festivals de cinéma, pas seulement Cannes, évoluent depuis un certain temps vers une décadence de plus en plus marquée. Comme le répètent les sorcières de Macbeth de Shakespeare : « Fair is foul, and foul is fair (ce qui semble « juste » et bon est réellement « mauvais » et vice-versa) » , une épitaphe appropriée à toute activité artistique…
On ne parlera pas ici du choix de la Semaine de la Critique, ni de la Quinzaines des Réalisateurs. On aborde également peu le choix d’Un certain regard qui est encore plus confus : prenons par exemple Girl qui a obtenu la Caméra d’Or. Le parcours émotionnel du protagoniste reste un peu trop intériorisé notamment dans la seconde moitié du film pour expliquer pleinement une fin qui sera sans doute l’une des plus discutées à Cannes cette année. Girl peut s’attendre à une vie de festivals, surtout par des distributeurs spécifiquement destinés aux audiences LGBT. Ce film montre une maîtrise cinématographique insuffisante par ses scènes répétitives du ballet et des discussions interminables qui ne mènent à rien avec le père. L’évolution narrative et émotionnelle est totalement absente.
Palme d’Or Affaire de famille
Tout au long de sa carrière, le cinéaste Kore-eda Hirokazu a entretenu les relations familiales et en particulier le lien père-fils dans son oeuvre, comme s’il détenait la clé pour déchiffrer l’âme de la société japonaise. Ce petit film est un ajout judicieux à ses paraboles sur les familles heureuses et malheureuses (Nobody Knows, After the Storm), parsemé de performances crédibles qui conduisent le spectateur à réfléchir sur les valeurs sociétales. Qui mieux que Kore-eda, un metteur en scène hors-pair, est capable de saisir les contradictions et les problèmes dans un style de conte sans contraintes? Bien que le rythme lent et mesuré du film soit parfois rebutant, cette sortie de Wild Bunch devrait peut-être voler quelques cœurs au-delà des fidèles du réalisateur, notamment avec le soutien du festival. Mais, étonnement, aucune critique presse n’a soulevé le fait que cette famille pauvre et « très sympathique » a kidnappé tout de même le premier enfant à ses parents et a presque kidnappé par la suite la petite fille. Dans Une affaire de famille, le réalisateur compare les émotions glaciales du comportement socialement correct avec la chaleur et le bonheur d’une famille malhonnête de la classe inférieure, où l’argent manque et toutes les méthodes de son obtention sont permises même apprendre à leurs enfants à voler.

Cold war de Pawel Pawlikowski, le réalisateur polonais qui a obtenu l’Oscar pour son film Ida, est encore une autre exploration de l’angoisse de l’ère soviétique du réalisateur. Le film suit la relation entre deux musiciens polonais qui traversent le rideau de fer, de Varsovie à Paris et au-delà. Il est « doux-amer ». Une triste ballade de deux amants qui ne supportent pas de rester à part, mais aussi parfois ne peuvent pas se supporter.
Palme de l’ennuie : Les filles du soleil et Plaire, aimer et courir vite
Le drame d’action d’Eva Husson, Les filles du soleil sur les femmes soldats kurdes combattant Daesh, opte pour une approche manipulatrice et ringarde. Le film est si peu subtil qu’il finit par nuire à son propre discours digne.
Plaire, aimer et courir vite de Christophe Honoré est l’histoire d’un étudiant français qui expérimente son éveil gay et tombe amoureux d’un homme qui a le sida. Le choix du réalisateur relève de l’invraisemblable. Pourquoi un jeune homme en bonne santé comme Vincent Lacoste veut s’engager dans une relation avec quelqu’un de 15 ans plus âgé que lui et qui va bientôt mourir du sida ?
Last but not least, la Palme d’Or aurait dû être attribuée au Poirier sauvage de Nuri Bilge Ceylan, qui a déjà remporté, parmi ses nombreuses récompenses cannoises, une Palme d’Or (Winter Sleep) et deux Grand Prix (Uzak et Once Upon A Time in Anatolia). Bien qu’il n’ait jamais été connu pour sa brièveté ou accessibilité, Ceylan reste fidèle à lui-même : il impose cette fois encore plus d’exigences à son audience dans une confrontation existentielle sobre, magnifiquement tirée, entre un fils et son père, qui traite beaucoup plus que le fossé entre les générations.

Le scénario de Ceylan révèle un monde provincial stagnant : Sinan (Aydin Dogu Demirkol) est un jeune homme sur le point d’obtenir son diplôme d’études supérieures pour devenir professeur, mais cherchant anxieusement un moyen de sortir du sort qui semble lui être tracé. En rentrant chez lui, il découvre que son père Idris (Murat Cemcir) se noie dans une dette due à une obsession du jeu qu’il n’admet jamais pleinement. La mère de Sinan, Asuman (Bennu Yildirimlar), noie son amertume dans les interminables séries télés fournies par les chaînes de télévision turques. Obstiné de devenir écrivain, Sinan cherche un moyen de publier son premier roman, mais ne parvient pas à obtenir un quelconque type de parrainage, ce qui signifie qu’il doit finalement payer pour la publication de sa propre poche. Contrairement à son fils, Idris est toujours charmant, un sourire sur le visage et une blague sur les lèvres; une façade joyeuse pour dissimuler les déceptions d’une vie gâchée. Certaines images sont en effet inoubliables, mais on doit constamment faire face à un ample texte et des sous-titrages dans lequel chaque mot compte. Le film de Ceylan révèle un monde provincial stagnant, des personnages qui manient leurs espoirs et leurs inévitables démissions à leur manière. Ses sources d’inspiration : Tchekhov et Dostoïevski, ajoutent plus de poids aux dialogues marathons, tandis que l’emplacement de Canakkale, près de l’ancienne ville de Troie et la bataille beaucoup plus récente de Gallipoli, apportent un certain nombre de références historiques. Les performances des acteurs sont toutes admirables.
Enfin, une séquence déchirante qui se déroule dans un verger paradisiaque, où une jeune femme, Hatice (Hazar Ercuglu), cherche désespérément un avenir. La mère de Sinan à un monologue émouvant avouant que malgré toutes les aggravations de sa vie conjugale, si elle avait eu une seconde chance, elle choisirait toujours le même mari. Il y a plus d’un brin d’ironie dans la conversation entre deux imams discutant des traditions islamiques et de la religion ou dans les rencontres de Sinan avec un écrivain établi, le jeune homme frustré espérant changer le monde alors que l’auteur plus âgé ne veut plus changer le monde s’inspirant peut-être de l’écrivain Roger Mondoloni : Changer le monde commence par se changer soi-même.
Norma Marcos