Curieuse expérience que de regarder Amère victoire en cette curieuse période de déconfinement confiné, ces hommes perdus au milieu d’un désert gris de cinémascope, dans une raréfaction du monde, dans un assèchement de la vie, comme notre propre vie peut elle aussi se raréfier et s’assécher.
Je parlais de l’abstraction à l’œuvre dans certaines parties de À l’ombre des potences du même réalisateur, mais que dire ici ? L’anecdote est réduite à sa portion congrue : pendant la seconde guerre mondiale, en Libye, un commando de l’armée britannique est chargé d’aller en territoire ennemi à Benghazi dérober aux Allemands des documents d’une extrême importance (mais dont on ne saura rien). Les deux hommes à la tête de ce commando, le major Brand (Curd Jürgens) et son subordonné le capitaine Leith (Richard Burton), s’entendent d’autant moins que Brand a appris que sa femme Jane (Ruth Roman) avait été autrefois la maîtresse de Leith. La guerre est une toile de fond qui n’intéresse Nicholas Ray que dans la mesure où elle oblige les hommes à se dévoiler dans leurs vérités les plus intimes et les plus contradictoires. Le générique s’inscrit sur le plan d’une salle d’entraînement où pendent des mannequins en toile avec les points faibles à attaquer, et un cœur à la place du cœur : les hommes ne sont déjà que des pantins qui portent bien en évidence leurs faiblesses et leurs histoires de cœur, en tout cas la guerre les réduit à cela (et la musique lancinante de Maurice Le Roux, saturée de percussions, accentue le malaise).

Dans cette guerre déréalisée, l’officier supérieur, le général Paterson (Anthony Bushell), légèrement crétin, joue avec un avion miniature, et n’aime pas Leith qu’il traite d’ « intellectuel » (parce qu’il n’est pas soldat de formation mais archéologue) et de « Gallois ». Le briefing de la mission (façon préparatif de casse dans les films de gangsters) se fait au-dessus d’une maquette assez énigmatique d’un blanc immaculé, avec une ou deux figurines disposées ça et là (comme les personnages courant vers un but inconnu des tableaux de De Chirico), qui ne nous aide pas beaucoup à comprendre ce qui doit se passer. Au bar un des soldats du commando distrait ses copains en mimant une bataille avec ses mains et des bruits de bouche (il sera le premier tué dans l’assaut). À plusieurs moments du film, on entend ce qu’on pense être un avion passer hors-champ (ce que Michel Chion appelle un son acousmatique, dont on ne voit pas la cause), les personnages lèvent la tête, éventuellement courent se cacher s’ils sont dans le désert, sans qu’on en sache plus sur l’éventuel avion ou qu’il y ait plus de conséquence. Une fois la fameuse mission accomplie, le commando se retrouve la nuit dans le désert, recherché par des Allemands en jeep; il y a soudain des explosions inexpliquées, comme une sorte de sinistre feu d’artifice, tout le monde se met à tirer sur tout le monde, des hommes montent des dunes en courant, des jeeps sont renversées au milieu de nuages de fumée ou de sable, des soldats sont tués, c’est beau sans qu’on comprenne ce qui se passe.

Mais si les actions prennent un aspect graphique et mystérieux, si le désert fournit un cadre dépouillé et minéral, il y a aussi dans le film une très grande sensualité. Ainsi dans la première partie de la mission, les hommes déguisés en Arabes se déploient lentement par petits groupes devant le bâtiment qui sert de QG à l’armée allemande, dans la nuit chaude de Benghazi, au milieu des enfants des rues et des badauds, dans un curieux décor mêlant arche en ruine, arbres tourmentés et architecture arabe : une superbe tension se développe, sans qu’un seul mot soit prononcé. Les regards de plus en plus anxieux, les gestes précis, l’espèce de ballet des hommes qui sortent leurs armes et s’approchent peu à peu de leur cible, tout cela m’a parfois fait penser au Pickpocket de Bresson dans la beauté des gestes chorégraphiés. Et puis Brand hésite, caché dans l’ombre avec la sentinelle allemande qui passe tout près de lui, son visage grimace, le couteau qu’il a sorti de son burnous tremble dans sa main. Leith s’approche, interrogatif (alors mec, qu’est-ce que tu attends ?) Et c’est Leith qui doit tuer la sentinelle, poignardant par derrière le jeune soldat allemand, dans un plan serré bref mais d’une étonnante charge érotique, les deux visages réunis par la mort, et Leith poussant en même temps que l’homme poignardé une sorte de plainte, douleur et orgasme mêlés. (Je dois avouer que j’ai regardé le plan plusieurs fois – c’est l’avantage du DVD, une première vision m’avait juste permis de voir une fulgurance sensuelle, mais il m’a fallu l’arrêt sur image et le ralenti pour voir les grimaces conjointes et semblables des deux visages, l’agonisant et le tueur.) Ensuite un long travelling suit le corps du jeune soldat, porté par Leith et Brand vers un coin sombre où ils l’abandonnent. Il y a aussi l’exécution d’une autre sentinelle par un soldat anglais, qui comme Leith poignarde l’homme en le surprenant par derrière, mais cette fois il entame avec sa victime une sorte de parcours macabre, sa main gauche sur la bouche de l’homme et sa droite toujours sur le poignard enfoncé près de la gorge, soutenant le mort et le faisant avancer devant lui comme s’il était vivant, pour s’approcher ainsi de l’entrée du QG allemand. C’est rapide, beau et terrible.

Il faut dire qu’il y a dans le film un certain nombre de cadavres et d’agonisants. Ce n’est pas la franche rigolade, et si l’on compte sur Amère victoire pour égayer une vie qui part en déréliction, en lambeaux et en quenouille, c’est raté. Je repense à ce plan très surprenant en plongée sur un gros Allemand couché sur le sable, la poitrine trouée d’une balle, mourant mais encore vivant, avec de petits scarabées noirs qui s’agitent autour de lui, sans doute attirés par le sang. Là encore, c’est d’une étrange beauté. Toute cette séquence, d’ailleurs, où Leith est laissé en arrière avec les morts et les blessés au milieu du désert, est particulièrement troublante.
Le problème du triangle amoureux est assez vite expédié par Ray, les séquences avec Ruth Roman entre Richard Burton et Curd Jürgens sont intenses mais brèves, et l’on se retrouve rapidement dans un univers exclusivement masculin. Dans ce monde où les jeunes soldats font de si jolis cadavres, les deux personnages principaux font un concours de névroses. Bien sûr il y a, comme dans beaucoup de films de guerre, le Courageux et le Lâche, et aussi l’Absurdité de la guerre. Mais ici le Courageux (Leith/Richard Burton) est aussi un grand dépressif, suicidaire, attiré et fasciné par la mort en général et les morts en particulier (il regarde longtemps et intensément le visage du soldat anglais qui vient de mourir tandis qu’il le portait, comme pour y chercher une réponse), et il éprouve lorsqu’il poignarde des soldats allemands une curieuse jouissance. Archéologue de profession, il trouve qu’une voûte berbère du 10ème siècle est « trop moderne » pour lui, et il semble préférer les vieilles pierres aux humains (c’est ce que lui reproche Jane, son ancienne maîtresse). Il parle des Romains qui ont bâti des villes magnifiques en Libye, et des « dead bones » (les squelettes) qui pointent sous le sable, écrasés par la guerre. Les dialogues avec Brand reviennent plusieurs fois sur le fait qu’il pousserait Brand à le tuer parce qu’il n’a pas le courage de le faire lui-même. Brand de son côté (le Lâche), a les yeux toujours un peu exorbités et le grand corps malhabile de Curd Jürgens, et ressemble à un grand enfant qui aurait du mal à contrôler ses pulsions. Incapable de tuer au corps-à-corps, officier jamais très sûr de lui et touchant sans cesse compulsivement sa poche poitrine où il conserve ses ordres écrits, il est jaloux de Leith, d’abord parce que sa femme Jane est encore manifestement amoureuse de lui, mais aussi parce que Leith a cette sorte de flamboyance dont il est lui-même totalement dépourvu (tant il est vrai aussi que dans le film l’incandescence est bien sûr du côté de Richard Burton – petit, d’accord, mais « hot » comme disent les Américains – et pas seulement à cause de la fièvre ou de la chaleur du désert). Peut-être aussi y a-t-il de l’homosexualité, refoulée ou non, dans cet affrontement, c’est bien sûr une importante possibilité de tout « film d’hommes » qui se respecte.

Quant à l’Absurdité de la guerre, elle est ici surtout réduite à l’absurdité de quelques comportements humains. Je me contredis, je me contredis toujours ! crie Leith à Brand vers la fin du film, et effectivement la cohérence psychologique préoccupe assez peu Nicholas Ray. Les personnages se contredisent eux-mêmes, le film se contredit, courage et lâcheté perdent leurs sens, et comme le dit encore Leigh, tous les hommes sont lâches pour certaines choses. Le Courageux est lâche, le Lâche est courageux, les personnages antagonistes se découvrent une troublante similitude. Dans cette question de lâcheté/courage, il semble qu’il y ait aussi une grande importance du regard d’autrui, comme si les personnages passaient leur temps à se mettre en scène, à composer pour les autres l’image qu’ils veulent donner d’eux (ou plutôt les images multiples, qui peuvent être différentes selon la nature du public). Celui qui est le plus préoccupé par cette sorte d’auto-promotion permanente est bien sûr Brand – et d’ailleurs le mot anglais « brand » signifie « marque », « étiquette », comme si son nom même le vouait à s’identifier à un label (le bon soldat, le soldat courageux, celui qui reçoit les médailles – mais au moment où il reçoit effectivement la médaille, il a depuis longtemps compris la vacuité de cette amère victoire).
Une des absurdités basiques du film, d’ailleurs, est de vouloir faire de Curd Jürgens, acteur allemand avec un fort accent, un officier anglais (ou bien est-ce une forme d’ironie de la part de Nicholas Ray, de faire jouer par un Allemand cet homme qui essaie tellement d’être un officier anglais exemplaire mais en est incapable ?) Mais plutôt que de se perdre en supputations oiseuses, revenons à l’historique du tournage. Nicholas Ray avait tourné un certain nombre de films magnifiques pour les studios hollywoodiens, travaillant jusqu’en 52-53 surtout pour la RKO de Howard Hugues, puis changeant régulièrement de crèmerie (en 54 Johnny Guitare pour Republic Pictures, en 55 À l’ombre des potences pour la Paramount et La fureur de vivre pour la Warner, en 56 L’ardente gitane pour la Columbia et Derrière le miroir pour la Fox, et en 57 Jesse James, le brigand bien-aimé à nouveau pour la Fox). Pour ce dernier film, il semble que Ray ait eu des problèmes avec le remplaçant de Darryl F. Zanuck à la tête de la Fox, Buddy Adler, qui l’oblige à remonter le film de façon conventionnel (alors que Ray voulait une structure éclatée avec des allers-retours entre les époques, comme dans le Lola Montès d’Ophuls sorti en 55). Fatigué de Hollywood, il veut tourner ailleurs, et décide d’adapter le roman Amère victoire de René Hardy (Hardy, c’est cet ancien résistant qui a senti le soufre toute la fin de sa vie parce qu’il a été accusé d’avoir dénoncé Jean Moulin auprès de la Gestapo, sans que l’affaire ait jamais été vraiment clarifiée – et on peut sans doute voir dans son roman le ressassement de sentiments de culpabilité, ce qui a dû aussi intéresser Ray). Ce dernier écrit un scénario avec son ami écrivain Gavin Lambert, sous la supervision de Hardy, et trouve le producteur français Paul Graetz pour lancer l’affaire, avec des fonds de la Columbia. (Graetz était, selon les mots de Gavin Lambert, un psychopathe qui haïssait les réalisateurs – mais nous ne le savions pas à l’époque).
Montgomery Clift devait jouer le rôle de Leith (le brave), Richard Burton celui de Brand (le lâche), et Curd Jürgens celui de l’officier allemand capturé pendant l’attaque. Mais Clift se retire de l’histoire, Ray pense alors à Paul Newman pour Leith, mais le producteur a l’idée de donner à Jürgens (devenu une grosse vedette européenne après Et Dieu créa la femme et Michel Strogoff) le rôle de Brand. Ray aurait alors été obligé de donner à Burton l’autre rôle principal, celui de Leith. Pour le rôle féminin de Jane Brand, que Ray décrivait comme « innocente et très anglaise », il veut

Moira Shearer, mais Graetz a déjà engagé l’Américaine Ruth Roman, qui n’a l’air ni anglaise ni innocente. Le tournage commence dans le désert de Libye. Le personnage de Brand joué par Burton devait être un grand névrosé, il devient un peu monolithique par le jeu limité de Jürgens. Une ligne de dialogue explique son accent allemand (il devient Sud-africain), et certaines répliques de Burton donnent l’impression qu’il verbalise ce que Jürgens n’est pas capable de jouer. Ray s’entend bien avec Burton et improvise beaucoup avec lui. De son côté Graetz depuis Paris fait réécrire le scénario par différents auteurs, et Ray reçoit tous les matins des télex avec les nouvelles pages, portant toujours la mention ajoutée par Graetz « Aucun mot ne doit être changé ! » Malgré la présence sur place de Mme Graetz comme productrice exécutive (mais qui devient la maîtresse de Jürgens), Ray parvient à mener sa barque sans trop s’ensabler. Mais le tournage prend du retard, Jürgens commence lui aussi à vouloir changer le scénario pour rendre son personnage plus sympathique, le sable porte sur les nerfs de tout le monde, Ray boit et passe des nuits à jouer au casino. Après 6 semaines de désert, le tournage se poursuit pendant 4 semaines en France, aux studios de la Victorine et à Paris. En post-production Ray essaie apparemment d’avoir Chostakovitch pour la musique, il va à Cannes montrer sa copie de travail à la délégation soviétique, qui trouve le film beaucoup trop « hostile au concept de héros ». Du coup il trouve un jeune compositeur français, Maurice Le Roux (élève d’Olivier Messiaen en même temps que Boulez, et qui travaillait dans les années 50 avec Pierre Schaeffer au studio de musique concrète de la RTF), qui lui écrit une impressionnante et minimaliste partition.
Le film est terminé à temps pour aller au festival de Venise, où il est assez peu apprécié, sauf par les petits gars des Cahiers du cinéma (Jean-Luc Godard, Eric Rohmer). Godard notamment écrit au début de sa critique du film le fameux « Le cinéma, c’est Nicholas Ray. » Aux Etats-Unis le film est un échec commercial, la Columbia change le montage en l’amputant de 20 minutes, et l’exploite comme film de complément dans des doubles programmes. En Europe le film est également mutilé, de façon différente dans chaque pays.

Toutes ces histoires autour du film peuvent être regardées (et sans doute avec raison) comme une illustration vaguement romantique du « cinéaste maudit » qui se bat contre le système et contre ses propres tendances à l’auto-destruction. Je lisais un article de James Harvey retraçant entre autres choses les péripéties du tournage, où il explique que Amère victoire a été pour Ray le début de la fin. N’empêche qu’après ce film, malgré son insuccès commercial et critique (à part donc dans les Cahiers du cinéma) et malgré l’éventuelle mise à l’index de Ray par les gros studios hollywoodiens, il a encore tourné La forêt interdite et Traquenard, deux films formidables, et puis Les dents du diable (que j’aime moins mais qui a beaucoup de qualités), avant de faire les super-productions sans doute beaucoup plus « commerciales » Le roi des rois et Les 55 jours de Pékin, dont je n’ai pas un souvenir ébloui mais qui n’ont rien non plus de déshonorant. Je trouve que pour quelqu’un qui déclinait et avait des difficultés à travailler, il était encore sacrément combatif et productif. J’aimerais bien avoir un déclin comme celui de Nicholas Ray.
Mais ne serais-je pas moi-même en train de m’enliser dans les circonvolutions sablonneuses de cet étrange film ? Ce qui déroute aussi dans Amère victoire, qu’on soit confiné ou pas, qu’on soit ou pas en train de suer sous son burnous, c’est qu’on y cherche en vain les éléments qu’on a appris à identifier dans la plupart des films de Nicholas Ray : pas de jeune délinquant torturé, pas de relations père-fils ou mentor-protégé, pas d’histoire d’amour flamboyante, pas de couleurs éclatantes (difficile en noir et blanc…). La violence, institutionnalisée par la guerre, y fleurit néanmoins de façon tout à fait surprenante et nous perturbe dans sa sensualité. Ce film très abstrait éclate parfois en floraisons charnelles d’une dérangeante beauté. Les personnages sont réduits à de brutales pulsions, à de puissants affects débarrassés de toute fioriture sociale. Ray adorait le CinémaScope, et ce qu’il fait ici dans le désert libyen avec le chef-opérateur français Michel Kelber est tout à fait épatant, d’une grandiose simplicité. Film déroutant, mystérieux, obscur et lumineux, qui porte fièrement l’étendard de la contradiction, de l’équivoque et de l’indécidable, Amère victoire est définitivement une expérience à tenter (sauf bien sûr si l’on a d’irrépressibles tendances suicidaires, auquel cas on préfèrera La mélodie du bonheur.)
Emmanuelle Le Fur
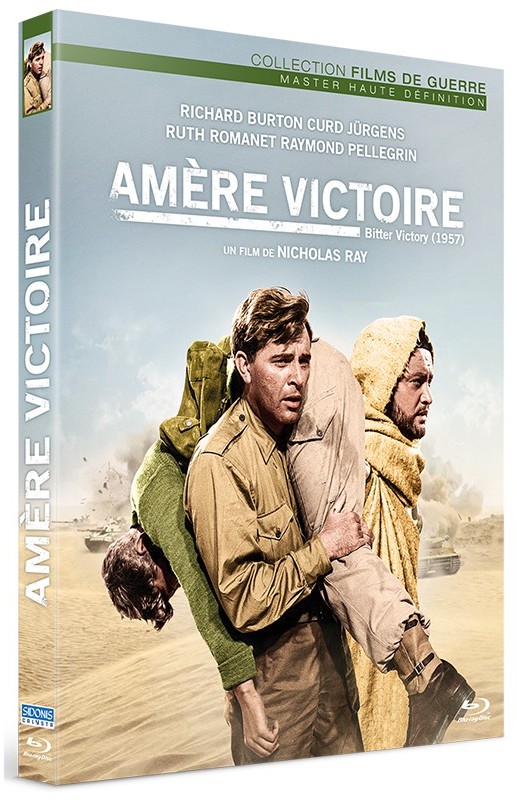
Amère victoire, est disponible en Blu-ray et DVD (master HD) dans la collection Films de guerre de Sidonis Calysta. En complément, une double présentation : Bertrand Tavernier a révisé son avis au fur et à mesure des visionnages. Le cinéaste trouve que « la musique de Maurice Le Roux est l’une des grandes réussites du film (.) une musique à la fois très moderne et lyrique qui traduit de manière très forte le drame intérieur qui anime le film ». Il évoque longuement René Hardy, résistant, auteur du roman, un des personnages de son film : Laissez-passer. Ainsi, que les rapports conflictuels entre Nicholas Ray et son producteur Paul Graetz (33 minutes). Patrick Brion, critique et historien, évoque l’histoire compliquée du film avec ses zones d’ombre, instructif et passionnant sur un « film qui est une réflexion sur le courage » (17 minutes). Une Galerie d’affiches du film et enfin sa bande-annonce (2 minutes).
Amère victoire (Bitter Victory) un film de Nicholas Ray avec Richard Burton, Curd Jürgens, Ruth Roman, Raymond Pellegrin, Anthony Bushell, Alfred Burke, Sean Kelly, Ramon de Larrocha, Christopher Lee, Ronan O’Casey, Fred Matter, Nigel Green… Scénario : René Hardy, Nicholas Ray, Gavin Lambert d’après le roman de René Hardy. Dialogue additionnel : Paul Gallico. Directeur de la photographie : Michel Kelber. Décors : Jean d’Eaubonne. Montage : Léonide Azar. Musique : Maurice Le Roux. Producteur : Paul Graetz. Production : Columbia Pictures – Transcontinental Films – Robert Laffont Productions. France – Etats-Unis. 1957. 102 minutes. Noir et blanc. CinemaScope. Format image : 2,35 :1. Son : Version Originale sous-titrée en français et Version Française. Tous Publics.
