(Classe américaine et french caméras)
Les gars, je veux une veste à franges. Je ne vous parle pas d’une banale veste à franges façon Le daim de Quentin Dupieux, franchement petit joueur. Non, une vraie veste à franges, comme celle de Roger Daltrey des Who dans Woodstock , veste blanche sur torse dénudé et avantageux, franges interminables, bras levés comme un bel archange blond et jonglage de micro sans que le fil s’emmêle dans les franges (hyper dur, des heures d’entraînement devant le miroir). Ou comme Sly and the Family Stone, lunettes violettes assorties aux touches de pourpre de la veste blanche, mouvements de bras qui agitent les franges toujours très photogéniquement. Ou comme Jimi Hendrix, super cool, bandeau rouge dans les cheveux et veste blanche avec des franges tressées de bleu, très économe de mouvements de bras – mais on n’a pas besoin d’effets de manche quand on est un dieu de la guitare électrique. Je veux aussi les bottes bleues à étoiles argentées de Joe Cocker. En ce temps-là, c’est sûr, les costumes de scène avaient de la classe (américaine).

Mais il n’y a pas que des franges et des étoiles dans Woodstock. Il y a d’abord, bien sûr, des tas de musiciens et de chanteurs, tous, dans leurs genres personnels, aussi investis et émouvants les uns que les autres. Il y a aussi une équipe technique nombreuse et parfois débordée par le nombre (prévu pour 50 000, le festival atteindra presque le demi-million de spectateurs) et par la météo (une sorte de mini-tornade suivie d’une pluie diluvienne de plusieurs heures qui transforme tout le terrain en champ de boue). Il y a de jeunes organisateurs un peu dépassés et finalement résignés à l’échec financier complet (les places étaient vendues 18$ pour les 3 jours – l’équivalent de plus de 100$ actuels, mais les barrières entourant le site furent rapidement enfoncées à plusieurs endroits, et le festival fut alors déclaré entièrement gratuit). Il y a des gens qui fument de la drogue, qui se baignent nus, il y a des problèmes d’approvisionnement, des petits-déjeuners pour 400 000 personnes, des riverains dont les avis sont partagés sur cette déferlante hippie. Il y a un employé fort aimable chargé de l’entretien des latrines qui explique qu’il a lui-même deux fils, l’un parmi les jeunes spectateurs et l’autre au Vietnam (employé qui malgré son amabilité a semble-t-il poursuivi les auteurs du film pour « angoisse mentale, gêne, ridicule en public et atteinte à la vie privée« ). Il y a des gens avec des bébés, d’autres qui font des malaises, il y a des embouteillages comme on n’en a jamais vu, un hélicoptère qui après la pluie laisse tomber sur la foule des fleurs et des vêtements propres. Il y a comme un parfum de liberté et de contestation dans l’air, et la guerre du Vietnam en arrière-plan de tout ça.

Et puis il y a des cameramen qu’on aperçoit parfois au détour d’un plan. On voit un cadreur derrière une Arri BL 16 sur pied, mais la plupart filment à l’épaule avec des Éclair 16. Conçue en 1960 par les ingénieurs français André Coutant et Jacques Mathot, la caméra Éclair 16 (fabriquée comme son nom l’indique par la société Éclair pour tourner en 16mm) est améliorée en 1967 par le moteur à quartz du jeune ingénieur Jean-Pierre Bauviala, qui permet d’avoir un son synchrone sans faire de clap. L’Éclair 16 va accompagner en partie l’essor de la Nouvelle Vague et du « cinéma vérité ». La notice de la caméra précise : « Éclair 16 autosilencieuse. La caméra qui ne se porte pas… elle repose sur l’épaule. (…) Sa forme très étudiée assure une stabilité absolue des prises de vues effectuées en portatif grâce à la répartition judicieuse du poids, au centre de gravité placé très bas, au magasin coaxial compact qui repose sur l’épaule et qui évite toute fatigue rapide. » Les gens qui ont rédigé cette notice n’ont manifestement jamais filmé eux-mêmes des concerts plusieurs heures durant avec cette caméra sur l’épaule. Sinon ils sauraient que non, elle ne se porte pas toute seule. Une Éclair 16 équipée pèse un peu plus de 6 kg, la partie inférieure (où se trouve le moteur) vous rentre dans la clavicule, pendant que votre main droite se tétanise sur la poignée mal placée. (Beauviala quittera assez vite la société Éclair pour fonder Aaton à Grenoble, et y développer sa propre caméra. En 1978 il décrit pour les Cahiers du Cinéma son premier contact avec l’Éclair 16 : « Alors là, horreur, je crois que c’est à ce moment-là qu’est né le projet de faire une autre caméra. Un engin tellement lourd et déséquilibré que j’ai immédiatement voulu fabriquer autre chose, un instrument plus amical, quelque chose comme le chat sur l’épaule qu’on a essayé de faire ensuite.« ) Bref, l’Éclair 16 à l’épaule, ça n’est pas une sinécure.

Les cameramen du film (cinq principaux au générique de fin, dont Michael Wadleigh, le réalisateur, et sept additionnels) ont à mon avis autant d’endurance et de virtuosité que les artistes qu’ils ont filmés. J’ai lu un témoignage racontant comment les types filmaient quasiment non-stop les concerts, ne dormant presque jamais, shootés à la vitamine B12 (et peut-être à d’autres substances), dans un état second, soûls de fatigue et de musique et littéralement sur les genoux (deux d’entre eux ont eu des entorses des genoux). Il y a des plans-séquences formidables, comme celui du premier morceau de musique du film, un seul plan de 6 minutes surHandsome Johnny par Richie Havens (qui avait dû ouvrir le concert à cause de multiples retards ou défections d’autres participants). La caméra épouse l’énergie, la fatigue et la concentration de ce chanteur noir folk qui met à rude épreuve sa guitare sèche (il jouait déjà depuis au moins deux heures au moment de cette chanson), elle ne le lâche pas une seconde, sans chercher non plus à filmer coûte que coûte le visage au moment où il chante, mais navigant de façon émotionnelle entre les mains, la guitare, le pied battant follement la mesure, et le visage tout entier absorbé par la musique.

Il faudrait aussi parler de la programmation musicale, légèrement incroyable, à quelques exceptions près : John Sebastian dont la chanson niaiseuse et le discours de ravi de la crèche laissent penser qu’il est là en bouche-trou et qu’il n’est peut-être pas en pleine possession de ses moyens; le groupe Sha-Na-Na (non moi non plus je ne connaissais pas), sorte de croisement improbable entre Devo (pour les costumes) et Bill Haley (pour la musique), dont tout le monde s’accorde à dire qu’on se demande ce qu’ils foutent là. Sinon, c’est du sérieux : Canned Heat, Joan Baez, Crosby, Stills & Nash, The Who (et la veste à franges précédemment citée), Joe Cocker, Ten Years After, Santana, Jefferson Airplane, Sly and the Family Stone, et j’en passe, et deux poids lourds pour la fin : Janis Joplin (dont la prestation a été rallongée dans cette version du film, parce qu’apparemment elle non plus n’était pas en possession de tous ses moyens suite à une très très longue attente avant de monter sur scène, attente comblée par de l’alcool et de l’héroïne – mais quel que soit son état, Janis Joplin sur scène, ça dépote), et puis Jimi Hendrix le lendemain matin du dernier jour, alors que le festival était officiellement terminé et qu’il ne restait plus « que » 30 000 spectateurs, qui joue entre autre sa célébrissime version déjantée de l’hymne américain. Sa prestation est ponctuée par des images du champ de boue et de décombres laissé par les festivaliers, comme un écho d’une guerre qui s’enlise au Vietnam et d’une Amérique en souffrance, au son d’une musique hallucinée et violente.

Il faudrait aussi évoquer la réjouissante inventivité du montage (cinq monteurs crédités au générique, dont Martin Scorsese en début de carrière, et celle qui montera nombre de ses films, Thelma Schoonmaker, tous deux également assistants-réalisateur). Le film utilise abondamment la technique du split-screen, ou écran divisé, à l’époque encore très rare (même si la chose existait dés le cinéma muet, et même si L’étrangleur de Boston de Richard Fleisher et L’affaire Thomas Crown de Norman Jewison en faisaient déjà grand usage en 1968, un an avant Woodstock). Ici l’idée, dont la paternité est attribuée tantôt à Wadleigh lui-même tantôt à Scorsese et Schoonmaker, est paraît-il venue de la nécessité de rentabiliser au maximum les 120 heures de rushes tournés presque en continu pendant les trois jours par les multiples caméras. On voit donc parfois deux ou trois images en même temps dans la largeur du format Scope, dans d’inépuisables variations de grosseurs de plans, de points de vue, de rythmes, rapprochant parfois des images qui selon la grammaire orthodoxe du cinéma ne devraient pas l’être (par exemple deux gros plans très similaires de la même personne filmés selon des axes très rapprochés, comme c’est plusieurs fois le cas sur Joe Cocker), utilisant le même plan dédoublé en miroir pour faire comme un écrin au plan du milieu, jouant aussi de la surimpression et du ralenti ou de l’accéléré, parfois épousant le rythme de la musique et parfois y faisant contrepoint, dans un dialogue constant des plans entre eux, déclinant le procédé dans une cascade d’effets ludiques, signifiants, jamais gratuits, pleins d’enthousiasme et de respect pour les personnes filmées. (Et j’oubliais la version karaoké du I-Feel-Like-I’m-Fixin’-To-Die Rag de Country Joe McDonald repris par des milliers de spectateurs, qui n’est pas du split-screen mais un autre exemple de la créativité des auteurs.)
Ce film épatant, qui a sans doute changé durablement la façon de filmer les concerts, reste un superbe et revigorant moment de cinéma et de musique.
Emmanuel Le Fur
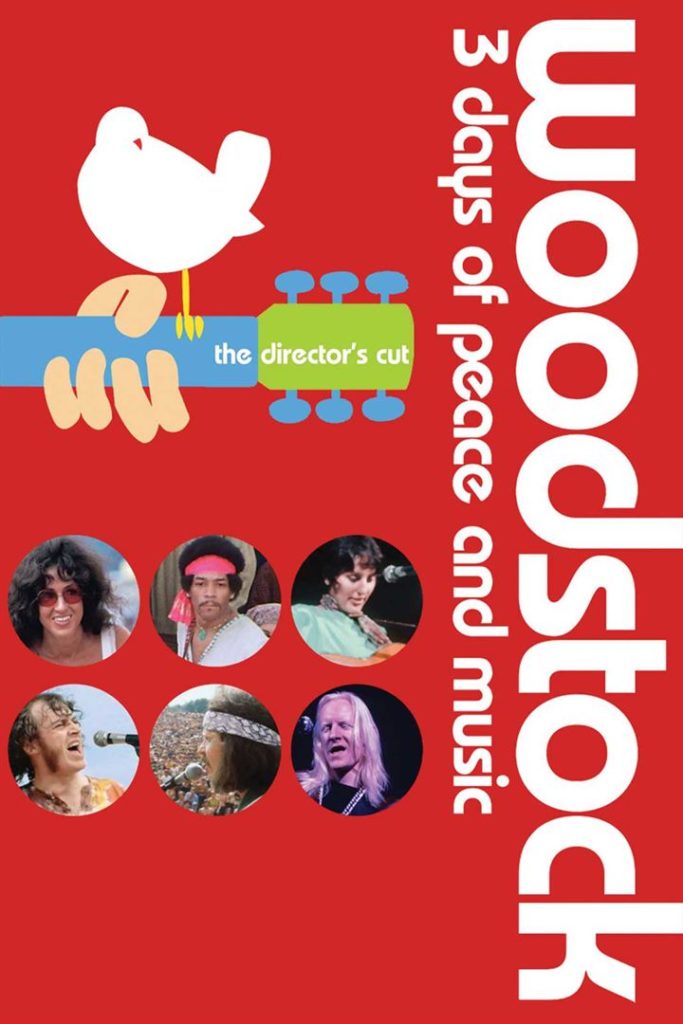
Woodstock, director’s cut, un film de Michael Wadleigh avec Joan Baez, The Who, Joe Cocker, Arlo Guthrie, Crosby Still & Nash, Santana, Jimi Hendrix, Canned Heat, Jefferson Airplane, Janis Joplin… Directeurs de la photogrpahie : Malcolm Hart, Don Lenzer, Michael Wadleigh, Michael Margetts, David Myers, Richard Pearce, Alfred Wertheimer. Montage : Jere Huggins, Thelma Schoonmaker, Martin Scorsese, Michael Wadleigh, Stanley Warnow, Yeu-Bun Yee. Assistant-réalisateur : Thelma Schoonmaker et Martin Scorsese. Producteur : Bob Maurice. Production : Wadleigh-Maurice Ltd – Warner Bros. Distribution France : Warner Bros. (Sortie director’s cut : le 20 septembre 2019). Etats-Unis. 1969-1970 / 2018. Durée director’s cut : 224 minutes (Première version 187 minutes) Couleur. Ratio image : 2.35 :1. Son : 5.1. Dolby Digital. Tous Publics.
